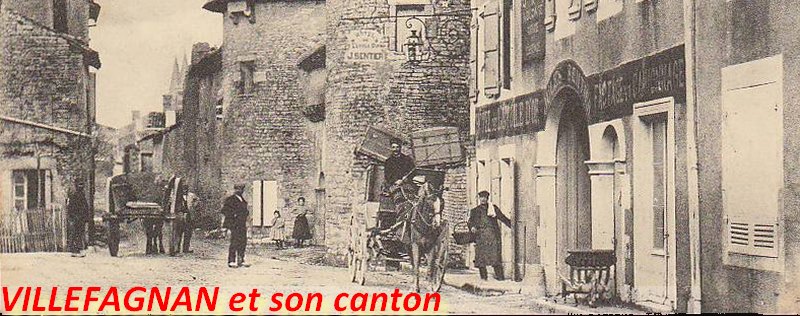
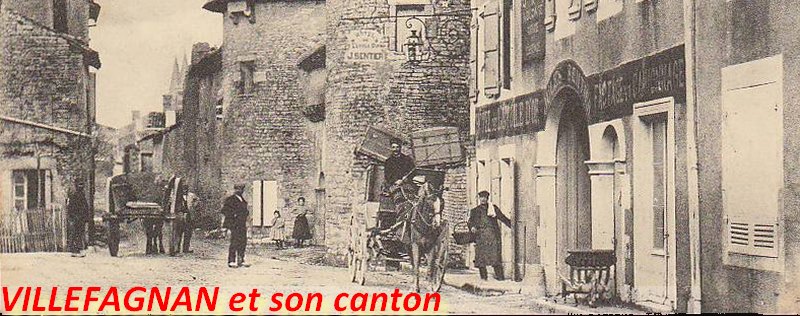
| La Faye | La Faye histoire La Faye église La Faye parc éolien La Faye maïs |



1761-1764 L'église doit être réparée
1761 : Requête communiquée aux habitants de la paroisse Saint-Vincent de La Faye de manière accoutumée pour délibérer devant notaire.
L’intendant de Limoges supplie le 1er juin 1761 humblement Toussaint Pierre Soullet prêtre curé de La Faye disant que l’église paroissiale dudit lieu a besoin des réparations les plus urgentes, les arcs-boutant doivent être refaits, le pavé raccommodé, et les vitraux verrés, ainsi que les fossés du cimetière du lieu (fossés qui entourent le cimetière), de sorte que s’il n’est incessamment pourvu aux réparations, l’église tombera en ruine, et causera une plus grande dépense…
Un devis sera fait. Les habitants délibèrent et consentent de faire faire à leurs frais les réparations à la nef de l’église et au cimetière de ladite paroisse.
Le 5 juillet 1761, devant Deloume, notaire royal, et au son de la cloche, le curé a convoqué tous les habitants de la paroisse les réunissant devant la porte de l’église. « Après avoir donné lecture de la requête de l’ordonnance ci-devant citée, les dits habitants se sont retirés, et après avoir conféré ensemble, ils nous ont rapporté que la couverture de la dite église est faite en pierre plate, que l’aile du côté du nord, la pierre qui sert de couverture est totalement fondue, laquelle a besoin d’être refaite à neuf depuis l’entrée de la dite église jusqu’aux cloches, que le larmier en pierre de taille menace ruine, que du même côté la couverture aussi en pierre qui est sur le degré qui monte au clocher a besoin d’être refait, la majeure partie de la pierre est fondue notamment contre le coin dudit clocher. Que du même côté le deuxième arc-boutant du côté de la porte d’entrée de la dite église a besoin d’être refait à neuf, les pierres de taille et le moellon sont fondus. Les deux autres arcs-boutants du même côté ont besoin d’être recrépis.
Le côté de ladite couverture du côté du midi aussi en pierre est probablement bon, mais a besoin d’être repassé et pour cet effet, il y manquera beaucoup de pierre. Du même côté, l’arc boutant qui est milieu est totalement ruiné, et est à refaire à neuf. L’arc boutant qui soutient le clocher du même côté aussi à refaire ainsi que les murs qui soutiennent le clocher. Les dits habitants soutiennent que ces réparations (au clocher) ne les concernent point mais qu’elles doivent être faites par le seigneur décimateur (les habitants n’ayant en charge d’entretien que la nef de l’église). Le pavé de ladite église a besoin d’être réparé en différents endroits et l’église blanchie. Les fossés qui sont autour du cimetière doivent être entretenus en quelques endroits. Laquelle visite est faite en présence de François Georget, sieur du Treuil et Maître jean Demondion, notaire royal, etc.
Le 26 décembre 1762, les réparations ne sont pas faites puisque Maître Louis Gabriel Lériget, avocat au parlement de la ville et marquisat de Ruffec, juge sénéchal du Marquisat de Ruffec, et subdélégué audit lieu de monseigneur l’Intendant de la Généralité de Limoges, écrit qu’il sera dressé un devis par des experts en présence du curé, du syndic, et des quatre principaux habitants de la paroisse de La Faye. Ce devis séparera les montants incombant aux décimateurs de ceux affectés aux habitants.
Le 27 décembre 1762, le devis est présenté au juge Lériget par René Poudroux, maître architecte, et André Bouquet, maître charpentier, les deux demeurant à Ruffec, experts nommés la veille.
Le 8 mai 1763, le devis (détail estimatif) est présenté à La Faye au curé et principaux habitants. Détails des achats et travaux :
Art 1. Pierre de taille à remettre aux jambages de la porte de l’église, 2 livres ;
Art 2. Fermeture, ferrure aux fonts baptismaux, morceaux de pierre des murs qui les enferment, 7 livres ;
Art 3. Six toises de pavés, 40 livres ;
Art 4. Deux toises de planches de chêne pour raccommoder le confessionnal, 18 livres ;
Art 5. Fermeture de la chapelle, porte à barreaux avec ferrure et serrure, 6 livres ;
Sous-total : 73 livres
Art 6. Cinquante pieds de verre et trois verges de fer pour le vitrail (haut de 5 pieds, large d’1 pied), 10 livres ;
Art 7. Deux tonneaux de chaux et quatre charretées de sable pour reblanchir la nef, 45 livres ;
Art 8. Deux supports de fer et demi, deux portes pour tenir le dais et la chaire (qui doit être raccommodée), 6 livres ;
Art 9. Deux morceaux de pierre qui manquent au ballet du frontispice, 6 livres ;
Art 10. Refaire à neuf des piliers, 30 livres ;
Art 11. Refaire les arcs-boutants (sable, chaux), recéper le pied du clocher, arracher les lierres et arbrisseaux, 190 livres plus 140 livres ;
Art 12. Dix charretées de pierre (de Planchard – Empuré) pour recouvrir la nef et la pause : 120 livres.
Art 13. Couverture du clocher à neuf (lattes et tuiles) et réparation des murs : 72 livres ;
Total : 522 livres
Le 20 mai 1764, réception des offres et soumissions (de la part des artisans), l’adjudicataire devra se charger de fournir les matériaux et les charrois. Les habitants sont informés devant l’église, à la suite de la messe, que l’adjudicataire des travaux va être choisi (vente à la chandelle) Jean Bouquet demeurant au village des Gordains paroisse de Ruffec s’offre pour un montant de 900 livres. Antoine Goyaud tailleur de pierre à Raix offre ses services pour 800 livres. Jean Bouquet aussi. Antoine Gavallet de Ruffec accepte pour 780 livres. Feu rallumé, Jean Collet demeurant paroisse de La Faye s’offre pour 595 livres. Puis 590 livres par Jean Bouchaud de La Faye…
Le travail sera fait par Jean Bouchaud dans les conditions prévues, selon le cahier des charges, mais… il lui restait dû encore 390 livres non recouvrés auprès des habitants.
Anne Robert Jacques Turgot, Intendant de la Généralité de Limoges, ordonne le 10 décembre 1764 à Paris, qu’en 1765, cette somme soit prélevée sur tous les habitants, propriétaires privilégiés ou non.

Une première cloche datant de 1673 a été fondue en 1806 pour fabriquer celle qui fonctionne aujourd’hui et qui porte sur la partie extérieure, la mention suivante en relief : "j'ai été bénie l'an 1806. J'ai eu pour parrain Mr Claude MIMAUD sous-préfet de l'arrondissement de Ruffec et pour marraine Mme Marie-Marguerite Hélène THOREL, son épouse qui m'ont donné le nom de SAINT-VINCENT. M. François COUTURIER, Maire de la commune de La Faye et Mr François MACHET son adjoint".
Les dîmes de la paroisse de La Faye
Le 17 octobre 1728, le curé de La Faye adresse une déclaration de ses dîmes et revenus au diocèse de Poitiers en vertu d'une décision de l'assemblée générale du clergé de France du 12 décembre 1726.
Il, Sémiot, se déclare curé ou vicaire perpétuel de Saint Vincent de La Faye à la nomination de M. l'Abbé de Nanteuil-en-Vallée.
Art. 1 : Le prieur de La Faye (seigneur de La Faye) doit annuellement au curé dudit, un gros (le gros est versé par le décimateur quand le curé ne perçoit pas les dîmes, donc n'est pas décimateur) de quarante boisseaux de froment et quarante boisseaux de méture (méteil) à la mesure de Ruffec, estimé bon an mal an quarante sols le boisseau; c'et le prix commun sur lequel les fermiers afferment leurs revenus en bled pour tous grains dans toute l'étendue du Marquisat de Ruffec. Soit 160 livres.
Art. 2 Mr. le Duc de Saint Simon, seigneur de Ruffec, doit par chacun an à la cure, comme gros décimateur de la paroisse de La Faye, un gras de 24 boisseaux froment et 24 boisseaux méture, que ledit curé est tenu de chercher audit Ruffec distant d'une lieue. Soit 96 livres.
Art. 3 Il est dû par an 12 boisseaux de froment, 12 de méture et 13 boisseaux d'avoine de rente foncière , mesure dudit Ruffec, sur 70 boisselées de terre, partie en bois, partie en terres labourables, située dans la paroisse. Soit : 74 livres.
Art. 4 Sur une petite portion de dîme pour la paroisse qui peut se monter par an à trente boisseaux de bled de tous grains, y compris 3 ou 4 boisseaux provenant de novales (dîmes sur les terres nouvellement défrichées, ou lors de la remise en culture de chaumes, bois, anciennes jachères) que ledit curé et ses successeurs ont droit de louer perpétuellement. Soit 60 livres.
Art. 5 Lève dans ladite paroisse une petite portion de vin blanc de dîme qui peut se monter à huit barriques dans les bonnes années, se vend au plus haut prix 10 livres la barrique et se donne annuellement à 7 livres et 10 sols. Soit 80 livres.
Art. 6 Total des revenus de la cure de La Faye : 470 livres. Sur laquelle somme doit être déduit près de 50 livres que ledit curé a donné tant en réparations qu'en acquisition pour une maison presbytérale, le curé n'étant pas logé et d'une rente de 10 livres, qu'il doit tous les ans sur ladite maison, partant lui reste : 400 livres. Il n'y a point du tout de casuel dans la paroisse, ni de fabrique, ce qui fait que le curé a l'obligation de fournir des cierges, du vin pour la messe de paroisse et tous les linges qui sont utiles à l'église, ce qui doit être aussi déduit sur le revenu de la cure par chacun an de 10 livres. Il faut aussi remarquer qu'il y aurait une autre déduction à faire, à savoir :
les décimes et autres impositions, la nourriture et les gages d'un valet, l'entretien d'un cheval dont le curé ne peut se passer, à cause d'une grande étendue et de la grosse peine qu'il y a tant dans la paroisse, et ledit curé n'a pour nourrir son cheval qu'un petit pré à amasser une demie brasse de foin, lui en faut en acheter tous les ans pour au moins trois ou quatre brasses, de sorte que ledit n'a du tout point de reste de son revenu à la fin de l'année.
Nous, curé soussigné, certifions et affirmons la présente déclaration véritable, de laquelle nous avons remis le présent double à Mr. le Syndic du Diocèse de Poitiers, déclarant au surplus que nous n'avons omis, que je "scache", aucun des biens dépendant de la cure en foy de quoi nous avons signé le présent à La Faye le 17 octobre 1728.
Signé : Semiot, curé de La Faye.
Écoutons Henri Dindinaud, ancien maire de La Faye et conseiller général du canton de Villefagnan.

"La partie la plus ancienne de notre église, la plus étroite, se situe à l'Est et date du XIIe siècle. Des collatéraux ont été démolis au XVIe siècle. La partie Est (côté chœur) a été ruinée. Les pierres composant la maçonnerie semblent attester une reconstruction ultérieure".

C’est à ce moment là que l'on a allongé l’église ancienne en sa partie Ouest.
En 1887, l’église est restaurée pour un coût de 7 500 F de l’époque.
Le maître autel en marbre est mis en place eu 1901.
Un autel en l'honneur des enfants tombés au champ d'honneur : "Le dimanche 18 avril 1920 a eu lieu en l'église de La Faye la bénédiction d'un autel élevé en l'honneur des enfants de la commune qui sont tombés au champ d'honneur. Toutes les familles de la paroisse étaient représentées à cette touchante cérémonie. M. l'abbé Baylot, ancien curé de La Faye où il a laissé de si excellents souvenirs, à prononcé une allocution faisant ressortir les qualités de chacun des héros de la commune. Des chants patriotiques et religieux ont été exécutés d'une façon remarquable par la jeunesse de la paroisse."


Reste de statue...
En 1950-1951 les belles dalles en pierre sont recouvertes du béton existant.
Les derniers grands travaux datent de 1985 : « jointage » des murs intérieurs ; en 1990, la couverture des nefs, et en 1992 celle du clocher.
En 1992 le beffroi a été renforcé et le fonctionnement de la cloche électrifié.